Le deuil chez les personnes âgées : accompagner la perte et la solitude
- Action NeurOptimum

- 13 oct. 2025
- 5 min de lecture
Dernière mise à jour : 12 déc. 2025

Vieillir, c’est accumuler une richesse inestimable de souvenirs, de relations et d’expériences. Mais c’est aussi être confronté à une réalité douloureuse : celle des pertes successives. Chez les personnes âgées, le deuil prend une dimension particulière. Non seulement elles peuvent perdre leur conjoint ou leur conjointe, mais elles voient aussi disparaître peu à peu des amis, des compagnons de route ou des membres de leur génération. Ce cumul de pertes provoque un sentiment de solitude profonde qui fragilise l’équilibre émotionnel et cognitif.
Dans un CHSLD, dans une résidence ou même à domicile, les proches observent souvent ce basculement : un parent autrefois actif et sociable qui devient plus renfermé, plus silencieux. Derrière ce changement se cache le travail du deuil, un processus normal mais parfois déstabilisant, qui mérite d’être compris et accompagné avec délicatesse.
Le cerveau en deuil : ce qui se passe à l’intérieur
Le deuil n’est pas seulement une expérience émotionnelle. C’est aussi une expérience biologique qui se traduit directement dans le fonctionnement du cerveau. Lorsqu’une personne âgée perd un être cher, plusieurs zones cérébrales s’activent simultanément. L’amygdale, qui gère les émotions de peur et de tristesse, envoie des signaux d’alarme intenses. Le cortex préfrontal, responsable de l’analyse rationnelle et de la régulation émotionnelle, tente de calmer cette tempête, mais il est rapidement débordé.
L’hippocampe, siège de la mémoire affective, ravive sans cesse les souvenirs liés au défunt, renforçant la douleur de l’absence.
Sur le plan neurochimique, la production de sérotonine et de dopamine (deux neurotransmetteurs associés à la régulation de l’humeur et au sentiment de motivation) diminue. Cela explique pourquoi les personnes endeuillées ressentent souvent une perte d’énergie, un découragement ou une impression de vide. Chez les personnes âgées, cette réaction est amplifiée par une diminution naturelle de la neuroplasticité : le cerveau s’adapte moins vite et le retour à l’équilibre est plus long.
Rappel – Ce qu’il faut retenir :
L’amygdale déclenche la tempête émotionnelle.
Le cortex préfrontal peine à réguler les émotions.
L’hippocampe ravive sans cesse les souvenirs.
La sérotonine et la dopamine chutent, entraînant fatigue et perte de motivation.
Vivre le deuil dans la vieillesse : entre perte et solitude
Le deuil chez une personne âgée ne se limite pas à la tristesse liée à la mort d’un conjoint. Il s’accompagne souvent d’un sentiment de solitude exacerbé. Lorsque l’on perd son partenaire de vie après plusieurs décennies de partage, c’est tout un équilibre quotidien qui s’effondre : les rituels, les habitudes, les petits gestes qui rythmaient la journée. Cette absence crée un vide non seulement affectif, mais aussi identitaire :
« Qui suis-je maintenant, sans lui ou sans elle? »
À cela s’ajoute la réalité du vieillissement : voir ses amis disparaître les uns après les autres, sentir que la génération à laquelle on appartenait s’efface peu à peu. Ce cumul de pertes renforce la vulnérabilité psychologique et accentue la sensation d’isolement, particulièrement chez ceux qui vivent en CHSLD ou qui n’ont plus de famille proche.
Rappel – Les défis principaux du deuil en vieillesse :
Perte du conjoint = perte d’un équilibre de vie.
Décès successifs d’amis = sentiment d’effacement.
Isolement social amplifie la souffrance.
Quand le deuil devient inquiétant : les signes d’alarme
Il est normal de ressentir de la tristesse et de la douleur après un décès. Mais il existe une différence entre un deuil normal et un deuil compliqué. Chez les personnes âgées, certains signaux doivent alerter : un isolement social marqué, un désintérêt complet pour la vie quotidienne, une perte d’appétit prolongée, des troubles du sommeil persistants, ou encore des propos exprimant un profond désespoir. Parfois, la personne peut même négliger ses soins médicaux ou manifester un désir de « rejoindre » la personne disparue.
Ces signes montrent que le deuil n’évolue pas vers une adaptation saine, mais vers une dépression ou une détresse psychologique majeure. Ils appellent une intervention rapide de la famille, des proches ou des professionnels.
Rappel – Signes à surveiller :
Isolement social marqué.
Perte de motivation et désintérêt.
Troubles du sommeil persistants.
Propos de désespoir.
Statistiques au Québec, au Canada et ailleurs
Le deuil chez les aînés est une réalité fréquente et documentée. Au Québec, près de 45 % des personnes de 65 ans et plus disent ressentir une solitude significative après la perte d’un conjoint (Institut de la statistique du Québec, 2022). À l’échelle canadienne, Statistique Canada estime qu’une personne âgée sur quatre vivant seule après un deuil présente des symptômes dépressifs cliniques.
À l’international, les recherches confirment cette vulnérabilité. Le phénomène du « syndrome du cœur brisé » (broken heart syndrome), une cardiomyopathie liée au stress du deuil, est documenté : le risque de mortalité augmente de 20 à 30 % dans les deux années qui suivent la perte d’un conjoint. Ces chiffres montrent à quel point le deuil n’est pas seulement psychologique, mais qu’il a aussi des conséquences directes sur la santé physique.
Deuil et maladies neurodégénératives : un double défi
Lorsque la personne endeuillée vit déjà avec une maladie comme Alzheimer, Parkinson ou une autre dégénérescence neurocognitive, le deuil prend une forme encore plus complexe. Dans la maladie d’Alzheimer, par exemple, certains patients
« oublient » par moments la perte, puis la redécouvrent, revivant ainsi un choc émotionnel à répétition. Chez les personnes atteintes de Parkinson, l’intensité émotionnelle du deuil peut aggraver les symptômes moteurs et la rigidité musculaire.
Les spécialistes en gériatrie et en neuropsychologie recommandent une approche adaptée :
Utiliser des repères concrets (photos, objets, musique) pour soutenir la mémoire affective.
Favoriser une stimulation douce des émotions.
Éviter de confronter brutalement la personne à la réalité de la perte.
Offrir un accompagnement interdisciplinaire : gériatres, psychologues gérontologues, travailleurs sociaux en soins palliatifs.
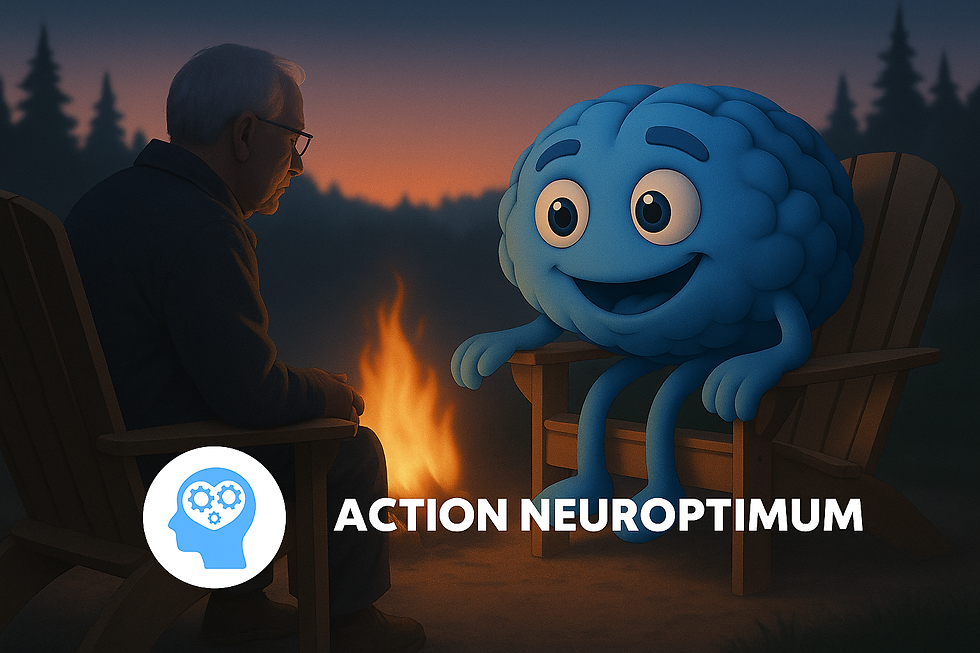
Comment accompagner une personne âgée en deuil?
Le rôle de la famille et des proches est central. Être présent, écouter sans juger, proposer des activités qui font du bien : ces gestes simples ont un impact énorme. L’accompagnement passe moins par les grands discours que par une présence régulière et bienveillante.
Les professionnels de santé, quant à eux, ont un rôle complémentaire. En CHSLD ou en soins à domicile, ils peuvent offrir des espaces de parole, repérer les signes de dépression et proposer des groupes de soutien. L’intervention interdisciplinaire permet d’adresser à la fois les besoins médicaux, psychologiques et sociaux.
Rappel – Clés pour aider :
La présence vaut plus que les mots.
Les liens sociaux protègent contre l’isolement.
Repérer les signes de dépression est crucial.
L’accompagnement doit être adapté à chaque individu.
Conclusion : redonner sens malgré la perte
Le deuil chez les personnes âgées n’est pas une simple étape de vie. C’est une réalité complexe qui touche l’émotion, le cerveau, le corps et le réseau social. Comprendre ce qui se passe dans le cerveau aide à reconnaître que la souffrance est bien réelle, même si elle ne se voit pas toujours.
Accompagner, écouter, soutenir et reconnaître la douleur : ce sont là les outils les plus puissants pour aider nos aînés à traverser cette épreuve. Même dans un contexte de maladie neurodégénérative, il reste toujours possible d’apporter du réconfort et de préserver des moments de sens et de lien.
Action NeurOptimum, pour rendre l’impossible… POSSIBLE!
📍 Boucherville, Québec
📅 Chaque lundi à 7 h, un nouvel article paraît sur notre blogue.
👉 Planifie ta lecture du lundi matin et reste à jour avec nos contenus hebdomadaires.




Commentaires